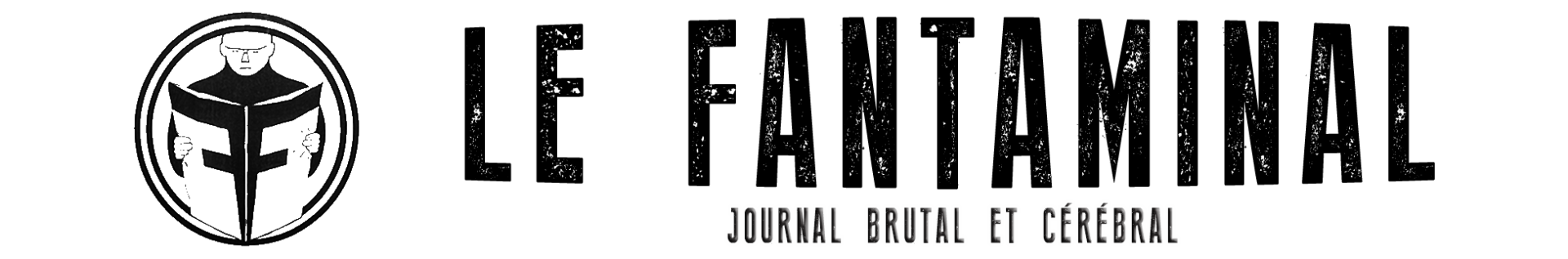Des fleuves et des hommes
L’eau est le berceau de la vie. On ne s’étonne donc pas que notre histoire prenne ses sources aux abords des grands fleuves, ces puissances de la nature où se reflètent toutes nos interrogations.
Par Lucien Bridel
En Chine, la civilisation a émergé sur les berges du fleuve Jaune, en Inde, elle s’est épanouie dans les vallées de l’Indus et du Gange, tandis que l’Égypte, nous apprend Hérodote, est un présent du Nil. Cependant, la civilisation sumérienne, celle que l’on considère comme la plus ancienne de toutes, s’est développée il y a plus de cinq mille ans dans « le pays entre les fleuves », autrement dit en Mésopotamie, entre le Tigre et l’Euphrate… « Il y a des plaines et des vallées que la Géographie semble avoir prédisposées à l’Histoire », écrit dans Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages, l’écrivain voyageur Sylvain Tesson. Une formule que ne renierait sans doute pas Georges Roux qui, dans les premières pages de son ouvrage La Mésopotamie, qualifie celle-ci de « don de deux fleuves jumeaux ». Une opinion nuancée par Bertrand Lafont, assyriologue et historien qui, au cours d’un entretien sur France Culture, affirme que le Tigre et l’Euphrate – contrairement au Nil – sont, depuis la nuit des temps, « craints autant qu’ils sont nécessaires ». Et pour cause : leurs crues et débordements sont particulièrement ravageurs et imprévisibles étant donné qu’ils dépendent de la quantité de pluie ou de neige, toujours variable, tombant sur les montagnes d’Arménie et du Kurdistan. Personne ne niera, cependant, que ces deux fleuves, comme l’écrit Roux, ont créé « au milieu de déserts une pleine qui, en étendue comme en fertilité, n’a pas d’équivalent dans les 3700 kilomètres de terres en majorité arides qui séparent le Nil de l’Indus ». Des éléments qui expliquent pourquoi la cité sumérienne de Mari, capitale du plus puissant royaume du Proche-Orient au troisième millénaire avant notre ère, ne fût pas bâtie directement sur les rives de l’Euphrate, mais sur une terrasse qui la protégeait de celui-ci. Une situation dont les habitants se satisfirent en construisant un canal pour amener l’eau à la ville. Ajoutons que si Mari sut se mettre à l’abri du fleuve et profiter de ses bienfaits, elle dû capituler par deux fois face à des puissances rivales. D’abord saccagée par les Akkadiens, les fondateurs du premier empire du monde, Mari sorti définitivement de l’histoire mésopotamienne lorsqu’elle fut incendiée et détruite par les Babyloniens environ mille ans après sa fondation.
De la permanente impermanence
Non seulement les fleuves font le lit des civilisations en favorisant les conditions matérielles de leur épanouissement, mais ils inspirent également les esprits. Car les fleuves, comme tous les cours d’eau d’ailleurs, charrient avec eux un cortège d’idées, un ban de représentations et de métaphores qui, depuis toujours, irriguent le questionnement relatif à la nature, au mystère et aux conditions de l’existence, mais aussi les mythes et légendes qui tentent d’y répondre. Voilà sans doute pourquoi les fleuves sont devenus, écrit Stéphane Ferret dans un recueil de textes intitulé L’identité, « un lieu commun philosophique ». Songeons, par exemple, à la maxime « On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve » qui, traversant le temps et l’espace jusqu’à nous, a alimenté des courants de pensée très souvent contraires, incarnant ainsi à merveille la thèse de son auteur – Héraclite l’Obscur – selon laquelle être, c’est devenir. Une intuition, une certitude immédiate, sans doute inspirée par la permanente impermanence des cours d’eau, tant elle reflète les oppositions, voire les contradictions, qui génèrent et façonnent l’existence.
Du mythe à la réalité
Filant même lorsqu’ils sont immobiles, les fleuves relient en descendant de l’amont vers l’aval, tout en séparant leurs rives l’une de l’autre. Sources de vie, dotés de pouvoirs purificateurs, les fleuves sont également chargés « d’une puissance de souillure apportant à toute chose ici-bas la destruction », écrit, en l’occurrence à propos du Styx (le fleuve infernal de la mythologie grecque), Jean-Pierre Vernant dans Mythe et pensée chez les Grecs. Un pouvoir loin d’être imaginaire, tant les remous de la réalité dépassent, bien sûr en capacité de dévastation, mais aussi en puissance d’évocation, ceux de la fiction. Il en est ainsi, et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, de ce que les océanographes nomment « le panache » ou « l’éventail du Congo » pour désigner l’altération que produit le fleuve Congo jaillissant dans l’océan Atlantique. Dans Congo. Une histoire, David Van Reybrouck donne de ce phénomène une description sombre et méditative tout en restituant l’impétuosité et l’effrayant bouillonnement du fleuve qui se jette dans l’océan avec une force telle « qu’il change la couleur de l’eau sur des centaines de kilomètres ». Van Reybrouck poursuit : « Quand j’en ai vu pour la première fois des photographies aériennes, je n’ai pu m’empêcher de penser à une personne qui se serait tailladé les poignets et les maintiendrait sous l’eau – mais éternellement. (…) Contrairement au Nil, le Congo n’a pas donné naissance à un delta paisible s’ouvrant sur la mer, mais son énorme masse d’eau est expulsée vers l’extérieur à travers un trou de serrure. » Une violence dont les Congolais voudraient bien profiter, tant son potentiel hydroélectrique est important. Huitième fleuve du monde en longueur, mais second par son débit, seul l’Amazone le dépasse. Pouvant atteindre plus de 200 mètres de fond par endroits, le Congo abrite une faune abyssale à l’apparence bien plus déroutante que celle de la redoutable et vénérée Mami Wata, une divinité de l’eau très populaire du Golfe de Guinée à l’Afrique centrale et dont Roland Pourtier nous dit, dans Congo, un fleuve à la puissance contrariée, qu’elle « prend souvent la forme d’une sirène, comme au Congo, parfois associée au serpent ».
Du nom des rivières
La présence d’un esprit ou d’une entité représentant le fleuve et sa volonté n’est en rien propre au continent africain. D’ailleurs, « les rivières et même les plus petites sont des personnes », explique l’écrivain Jean-Christophe Bailly au micro de France Culture : « On peut ajouter qu’il y a des rivières enfant, des rivières adultes et puis qu’il y a de vieilles rivières… Chaque rivière est une individualité. On le sait par le nom qu’elles ont reçu, puisqu’il n'y a pas de rivière anonyme et que même le dernier petit torrent a un nom, du moins un nom local. » Les Néo-Zélandais ne diraient pas le contraire, eux dont le parlement vient d’approuver une loi accordant sa personnalité juridique au fleuve Te Awa Tupua. La voilà, peut-être, la solution pour protéger la biodiversité : intégrer la pensée indigène et sa conception de la nature à l’ordre juridique des Etats de droit et rendre aux fleuves l’importance qui est la leur. Mythique et vitale.
Bibliographie
Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages, Sylvain Tesson,
La Mésopotamie, Georges Roux, Points
L’identité, Stéphane Ferret, GF Flammarion
Mythe et pensée chez les Grecs, Jean-Pierre Vernant, La Découverte Poche
Congo. Une histoire, David Van Reybrouck, Babel
Congo, un fleuve à la puissance contrariée, Roland Pourtier, CNRS éditions